| -
Officiers et anciens élèves -
Alphonse Alexis GUIERRE
(1847 - 1904)

Né le 11 juin 1847 à
LUXEUIL-les-BAINS (Haute-Saône) - Décédé le 15 février 1904 à
SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique).
Père de
Georges Léon Jacques,
Gabriel Abel,
Maurice Casimir Lucien,
Félix Marius et René Jean
Albert, ainsi que de Marguerite Mathilde.


Remerciements photo /
Isabelle Peinaud
Entre dans la Marine en 1864.
Aspirant le 2 octobre
1867, port CHERBOURG.
Enseigne de vaisseau le
2 octobre 1869.
Chevalier de la Légion
d'Honneur le 6 juin 1871.

Officier en second sur le bâtiment "ESPADON"
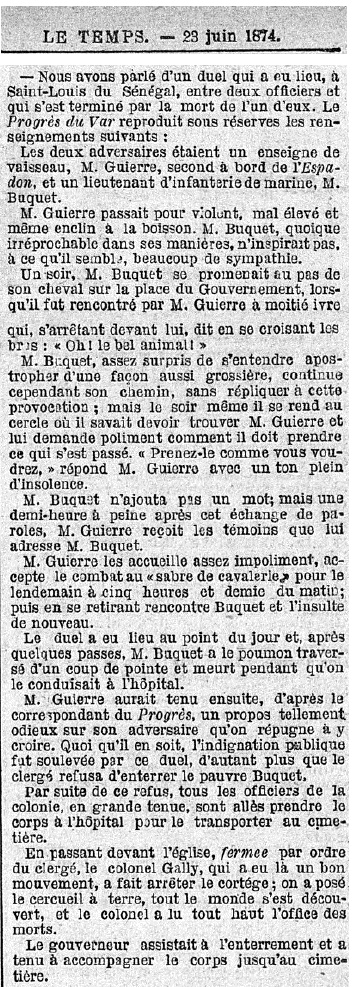
Extrait Le Temps / 28 juin 1874
Lieutenant de vaisseau
le 17 août 1878.
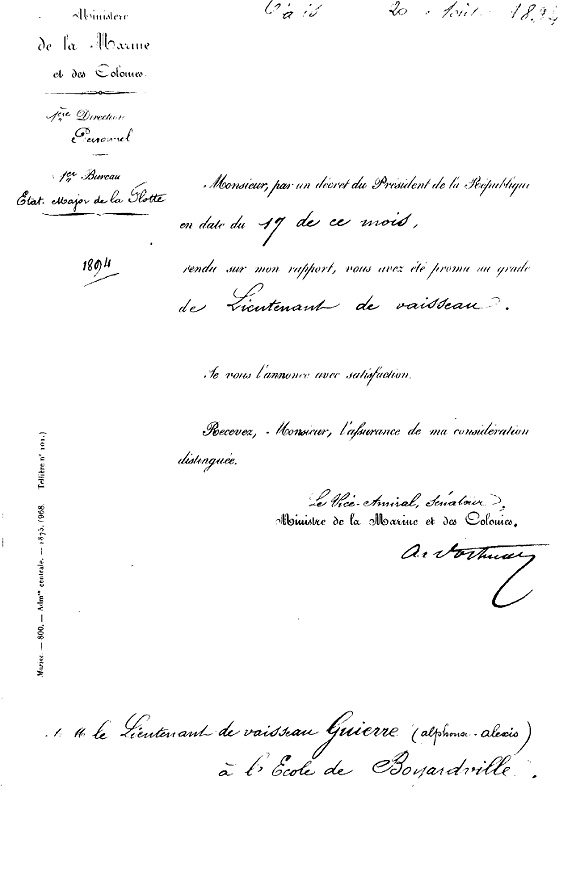

Au 1er janvier 1881,
sur le croiseur "LA-CLOCHETERIE", Station navale de la Mer des INDES
(Cdt Aristide VALLON).
Lieutenant de vaisseau
en résidence fixe.
Au 1er janvier 1886,
attaché au service du port, de la rade, des défenses sous-marines à
TOULON. Idem au 1er janvier 1897.
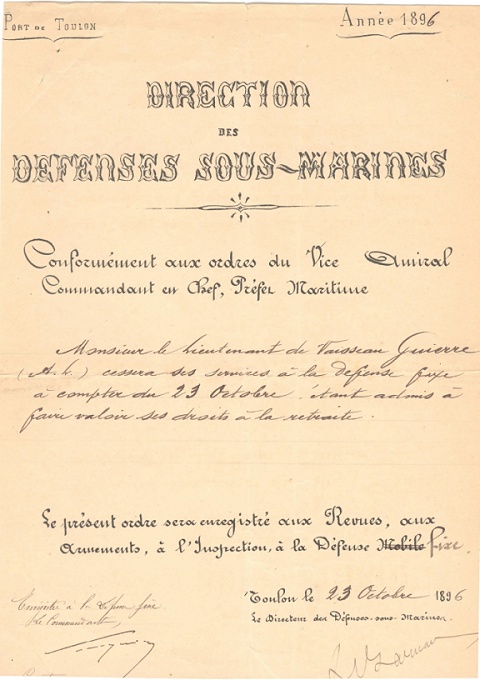
Versé dans le cadre de
réserve le 12 mai 1899.
Officier de la Légion
d'Honneur le 26 juin 1899.
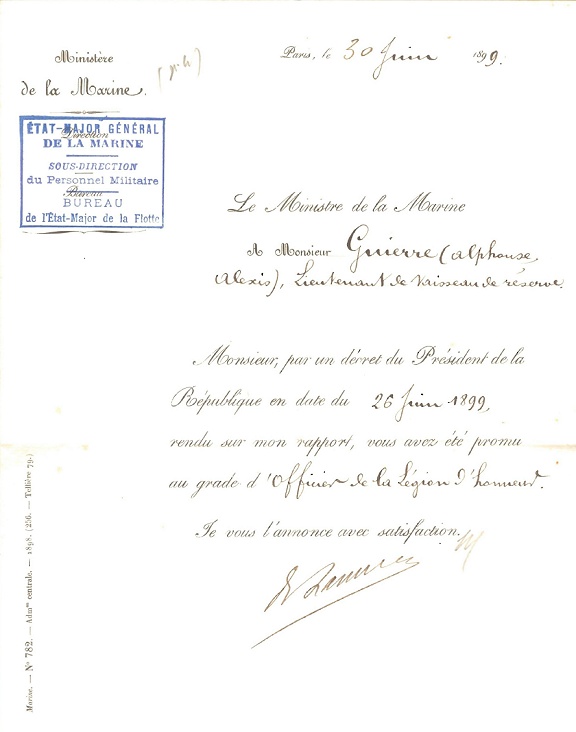
Occupe ensuite les
fonctions de Pilote Major à SAINT-NAZAIRE; fonctions qu'il occupe à
son jour de décès.
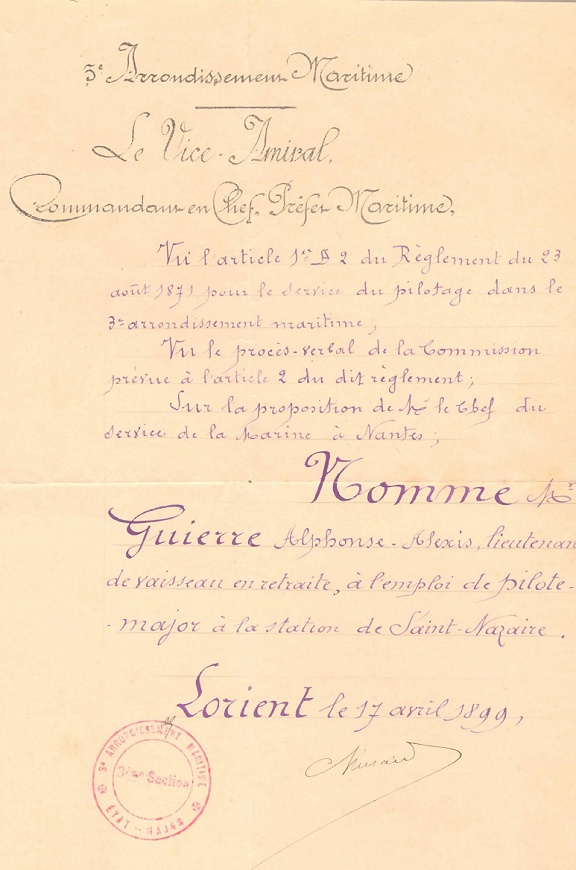
Trésorier des invalides
de 2ème classe, Trésorerie de Morlaix

 Cliquez sur l'image pour agrandir
Cliquez sur l'image pour agrandir
Ecrivain :
L'avenir de la torpille et la guerre
future
Dossier Légion d'Honneur /
Lien web
Complément :
Alphonse Guierre était
un intime de Pierre Loti, surnommé "Droit Devant". Etait considéré
comme son "ami terrible"
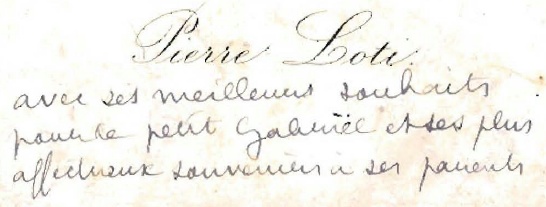
Portait le nom de "Rayer", dans un des ouvrages de Pierre Loti




Cliquez sur les images
pour agrandir
Retranscription
Ce "DROIT DEVANT",
L'"AMI ce TERRIBLE" DE LOTI
Qui était ce Rayer ? Ce nom n'est, à notre connaissance, cité qu'une
fois dans l'œuvre de Loti, plus précisément dans Un Jeune Officier
pauvre, où l'on peut lire, à propos du stage du marin-écrivain à
l'Ecole de Joinville : « Là, au premier, porte à gauche, on trouve
Rayer, un enseigne de vaisseau, mon grand ami (ce terrible qui a tué
un homme en duel au sabre). Nous faisons domestique commun et
porte-monnaie aussi ».
Rayer ? En fait, l'une
des figures les plus attachantes de la vieille marine. On l'appelait
« Droit devant ! », tant pour son cran que pour son allure. « Droit
devant ! », parce qu'il était grand, sec, toujours tendu vers le
but, précédé d'un nez en éperon et d'une barbiche en pointe, pas
plus hésitant dans sa parole que dans son geste, l'un et l'autre
expressions immédiates, sincères, totales de sa pensée. Il tranchait
par « oui » ou par « non » comme il tirait à l’'épée. « Droit
devant, mon fils ! et après, tant pis ! », telle était sa devise.
D'ascendance terrienne,
originaire de l'Est — où l'appel de la mer se fait si souvent
entendre — il avait préparé le concours de Navale à Paris, dans ce
collège Barbet, impasse des Feuillantines, dont les maîtres
professaient des opinions politiques avancées, certains allant
jusqu'à porter l'habit saint-simonien.
Il entra à l'Ecole
navale, trois ans avant Loti, avec les opinions d'un radical sous
l'Empire ; ce qui n'empêcha pas ses camarades d'aimer en lui le gai,
l'intrépide compagnon, mais n'allait pas tarder à « braquer »
certains de ses chefs.
Il terminait un tour du
monde quand, en juillet 1870, il fut, sur sa demande, incorporé au
5^ bataillon de marins à Brest et prit part aux combats de l'armée
de la Loire.
En avril 1871,
participant avec ses marins au second siège de Paris, il sortit des
tranchées sous le feu des communards, franchit fossés et remparts,
préparant ainsi l'entrée du Capitaine de frégate Trêves par la Porte
d'Auteuil. Il reçut la Légion d'Honneur, pour faits de guerre, à 23
ans. Avant la fin de l'occupation, se trouvant à Belfort, il insulta
un détachement allemand, cracha sur son drapeau ; ses amis
l'entraînèrent jusqu'à la gare où il sauta dans un train en marche,
après avoir jeté à la tête d'un employé la monnaie allemande que
celui-ci entendait lui faire accepter. Il fut condamné par
l'occupant à dix ans de forteresse — par contumace — car déjà il
faisait route pour le Sénégal.
C'est à Dakar, en
1873-1874, que Rayer se lia d'amitié avec Loti. Ils y vécurent
ensemble dans une case que Loti décrit ainsi dans Le Château de la
Belle-au-hois dormant : « Oh ! le Dakar d'autrefois, où nous
possédions en commun une case, une case de bois bâtie, disais-tu,
avec des débris de caisses de vermouth et hantée par les fourmis
blanches, les serpents et les lézards ».
C'est pendant cette
période qu'au hasard des escales se rencontrèrent à Dakar : Rayer,
Viaud, Duboc, Réveillère, Savorgnan de Brazza (aspirant sur la «
Vénus ») et le médecin de marine Crevaux, le futur explorateur.
La France était riche
de tempéraments exceptionnels. C'est à Dakar aussi qu'eut lieu le
duel auquel Loti fait allusion et qui se termina par la mort du
lieutenant d'infanterie coloniale B..., adversaire de Rayer. Nous
avons sous les yeux la dépêche ministérielle, signée par l'amiral
Montaignac, le protecteur de Brazza, infligeant un blâme à
l'enseigne de vaisseau Rayer. « Tout en reconnaissant qu'une fois le
duel devenu inévitable cet officier s'est comporté avec loyauté
vis-à-vis de son adversaire ; qu'il a manifesté le regret de voir
choisir une arme qui, dans sa pensée, devait donner une issue
funeste à la rencontre ; qu'enfin, il a cessé le combat malgré
l'insistance de M. B... et avant d'avoir pu comprendre la gravité de
la blessure qu'il venait de faire à cet officier ; il me paraît
incontestable que c'est à la légèreté et au peu de convenance de la
conduite de M... [Rayer] au début de cette affaire, qu'il faut en
attribuer les conséquences déplorables. En retirant ou en expliquant
des paroles insultantes que rien dans l'attitude de M. le lieutenant
B... n'avait provoquées. M... [Rayer] pouvait, sans manquer aux lois
Préface pour un livre qui n'a jamais paru, du véritable honneur,
éviter ce duel dont le dénouement a été si fatal. » Les paroles
insultantes avaient été, en fait, prononcées au cours de
l'altercation que voici : — « Quelle belle bête ! » s'était écrié
Rayer en voyant le lieutenant arriver à cheval. — « Pour qui faut-Q
le prendre, Monsieur ? » — « Pour qui vous voudrez ». A cette
époque, pareil sous-entendu suffisait à vous conduire sur le
terrain. L'officier avait choisi le sabre de cavalerie. Peu
familiarisé avec cette arme, le marin s'était d'abord blessé
lui-même au talon, mais avait voulu continuer le duel. Ce qu'il
avait fait en épéiste ; s'étant découvert, le lieutenant avait eu la
poitrine perforée. Conséquence hors de mesure avec les paroles
prononcées ; mais, nous apprend Rayer dans une annotation : « Je ne
pouvais pas crier urbi et orbi que je me battais pour le compte d'un
médecin boiteux et chargé de famille, souffre-douleur du lieutenant
B... »
Le bon droit était à
coup sûr de son côté puisqu'il garda l'amitié de Loti. Nous avons en
outre dans nos dossiers une lettre signée de tous les sous-officiers
de « l'Espadon » exprimant à l'enseigne de vaisseau Rayer leur
chagrin de le voir débarquer et renvoyer en France.
La lettre est du 18 mai
1874. Julien Viaud, ayant embarqué sur ce même aviso le 25 mai,
n'avait rien pu ignorer de ce duel qui fit quelque bruit dans la
Marine. En septembre de la même année, Julien Viaud rentre en France
avec son bateau ; aux derniers jours d'octobre, il fait un court
voyage privé en Savoie, puis séjourne à Paris. Il retrouve là son
ami Rayer, un peu désorienté par sa tragique aventure. Lui-même
porte au cœur une blessure mal fermée, l'amour que lui inspira
certaine jeune femme connue à Saint-Louis et qu'il vient de revoir à
Genève. Rayer et Viaud décident de demander leur admission à l'école
de gymnastique de Joinville-le-Pont (stage de janvier à juillet
1875). « Période joyeuse et drôle », écrira Loti dans Un Jeune
Officier pauvre, « durant laquelle nous étions du matin au soir en
équilibre ou en garde, ou bien encore, tantôt par les pieds, tantôt
par les mains, suspendus à quelque chose ».
Après les examens de
sortie, Us s'en furent ensemble faire leurs adieux au capitaine
instructeur qui leur offrit un pernod d'honneur et leur serra la
main, en disant à chacun : « A la Gloire, mon brave ! » Puis Loti
rejoignit l'escadre et embarqua sur" La Couronne qui devait le mener
en Turquie où il allait rencontrer l'amour et la gloire littéraire
en la personne d'Aziyadé. Rayer, moins bien partagé, cingla vers
Terre-Neuve. Revenu en France avec une santé assez ébranlée. Rayer
demanda de suivre les cours de l'école des torpilles à Boyardville.
Sa formation technique,
sa culture scientifique, allaient faire de lui l'un des premiers
électriciens et l'un des officiers torpilleurs les plus avertis de
la Marine. Mais, sitôt promu lieutenant de vaisseau, il repart au
loin, vers la Mer Rouge. A Aden il apprend le massacre en Abyssinie
de son ami Lucereau, explorateur ; il l'attribue à l'Intelligence
Service et, à la première occasion, jette un paquet de cartes de
visite à la figure d'officiers anglais, leur reprochant d'appartenir
à une nation d'assassins et leur proposant un duel au sabre. Son
commandant le jugeant dangereux pour la politique de la France — on
le comprend — , le renvoie à Toulon où il est mis aux arrêts de
rigueur.
Dans sa chambre,
strictement gardée par un factionnaire. Rayer grelotte de fièvre et
pourtant son seul désir est de repartir en campagne. C'était
l'époque où, après les explorations de Bonaparte Wyse, le percement
de l'isthme de Panama était étudié par F. de Lesseps. Déjà Duboc
s'est fait mettre hors cadres pour y participer. Armand Reclus,
officier de marine, frère d'Elisée et de Michel-Elie Reclus, dirige
les premiers travaux. Rayer se fait appuyer par un de ses anciens
chefs qui annote ainsi sa demande : « Compagnon de l'armée de la
Loire, travailleur, instruit, plein de verve et de gaîté ; qualités
de cœur exceptionnelles ; enfin, homme sûr pour toute mission
difficile. » Grâce à quoi. Rayer rejoint son ami fraternel Duboc
dans la brousse panaméenne ; la machette en main, son théodolite
sans cesse en œuvre, il établit en deux ans le premier tracé du
canal projeté. Si sa santé chancelle, sa fougue reste intacte.
Lorsqu'il se décide à rentrer en France, il prend la parole à
l'issue d'un banquet de sa société et, levant sa coupe, exprime le
souhait d'obtenir un commandement qui lui permettrait de conduire au
bagne les dirigeants de l'entreprise... A la suite de quoi, il reçut
de son camarade le lieutenant de vaisseau Henri Danel, gouverneur de
la Guyane, membre de l'opposition au congrès de 1879 pour le canal
de Panama, un mot félicitant le « vieux brave » (30 ans !) pour la
façon énergique et honnête dont il avait qualifié en s'en séparant
cette folle entreprise.
Rayer rentre en France.
Va-t-il enfin se fixer ? Non ! Nous sommes en 1883. Rayer retrouve
son ami Savorgnan de Brazza que Paris vient d'accueillir en
triomphateur, il envisage de repartir avec lui ; mais il apprend
alors la disparition de son ami le Docteur Crevaux, au cours de son
exploration du rio Pilcomayo. « Mort, Crevaux ? rien ne le prouve ;
il faut partir à sa recherche ! S'il était Anglais, dix expéditions
l'auraient déjà fait ! » Pourquoi Rayer ne le ferait-il pas, lui,
familier de la brousse et, depuis peu, membre de la Société de
Géographie de Paris ? Mais, où trouver les fonds ? M. de Lesseps,
président, ne pourrait-il les obtenir ? Un peu naïvement. Rayer lui
écrit : « Je ne veux pas lâcher la partie. Je préférerais gagner mon
passage à Buenos-Aires sur un voilier en donnant la main à la
manœuvre. Il me suffirait d'un mot de vous et, jusqu'à nouvel ordre,
nous irions à la recherche de Crevaux à nous deux, vous, Monsieur de
Lesseps et moi. » Mais le président de la Société de Géographie qui
n'a pas oublié le toast de Panama se montre assez réticent.
Peut-être la Marine sera-t-elle plus compréhensive ? Mais le chef d
'Etat-Major général pose au bouillant officier cette alternative :
ou rentrer dans le rang ou démissionner. Découragé, Rayer est sur le
point de permuter avec un camarade désigné pour le Sénégal où sévit
la fièvre jaune ; l'amiral Galliber l'en détourne.
Alors seulement, il se
résout à se fixer. C'est que depuis sept ans (il en a 37), au cours
de ses pérégrinations, un amour l'accompagne qui va triompher. Il va
enfin se marier. Ses camarades ne le veulent point croire : «
Impossible ! Quelle peut être la naïve jeune fille qui entend
enchaîner ce fils de l'Aventure ? » Et pourtant, l'impossible va se
réaliser. Rayer a demandé à Pierre Loti d'être son garçon d'honneur,
mais l'écrivain lui a répondu : « Tu as dû recevoir hier ma dépêche
te disant qu'il m'est impossible de venir. J'ai peur que tu n'en
sois pas bien convaincu, ce qui me ferait beaucoup de peine. Une
permission m'a été refusée de la manière la plus formelle. Tu dois
bien connaître de longue date l'entêtement des vieilles brutes
maritimes. Et je n'ose pas tirer bordée parce que, le mois prochain,
j'aurai besoin de la bonne volonté des mêmes vieux bonzes pour
m'absenter souvent en vue de m£ marier moi-même ». Je trouve, mon
cher Rayer, que tu as pris le seul parti sage et je suis heureux de
te voir faire cette douce fin-là. A moins d'impossible, je vais
manœuvrer moi aussi pour te suivre bientôt. Je t'envoie tous mes
souhaits de bonheur, ne pouvant faire mieux ; je t'assure encore de
ma vieille amitié et je t'embrasse. Julien ViAUD.
Certains seront choqués
peut-être par les sévères épithètes dont usait Pierre Loti à l'égard
de ses chefs. Nous voilà loin du langage académique. Pourtant, nous
aurions eu scrupule à ne pas publier une telle lettre dans son
intégralité. Julien Viaud adorait la marine et les marins mais, tout
comme son « terrible » ami, il jugeait sévèrement une certaine
oligarchie que nous allons voir sous peu rendre à tous deux la
monnaie de leur pièce. Donc, « Droit devant » s'est marié ; sa
fiancée a relevé le défi de l'opinion maritime. Mais la Terre va
prendre sa revanche sur la Mer. Quelques mois après le mariage, l'un
de ses chefs envisage d'envoyer le lieutenant de vaisseau Rayer au
Gabon.
Mme Rayer, pourtant si
douce, parle simplement de l'aller cravacher. C'est que, déjà, elle
sent battre en elle le cœur de son premier enfant. Bientôt le
fougueux, le terrible « Droit devant » va se montrer plus père que
marin. Rayer aura sept enfants. Dès la naissance du second, il a
demandé de passer en résidence fixe. Mais ce « pantouflard » va
organiser toute la défense de la rade de Toulon par torpilles fixes.
Il occupe ses rares loisirs à traduire de l'allemand de savants
ouvrages sur l'électricité et à faire des mathématiques, sa passion.
Pour faire face à des
charges familiales devenues écrasantes, il prépare à l'Ecole navale
des fils de camarades (dont Jean Conneau, le futur aviateur), ce qui
déplaît à ses chefs
En fait. Loti ne s'est
marié qu'en novembre 1886, d'autant que sa liberté de langage n'a
pas diminué avec l'âge. L'ancien élève de professeurs
saint-simoniens ne va ni aux réceptions de la Préfecture maritime,
ni à l'église (bien que ses enfants soient élevés dans la religion)
; c'est un radical. Le temps est venu où il devrait être promu
capitaine de frégate.
Mais... Le jour même du
baptême de son sixième enfant, à la fin du déjeuner, alors que le
commandant Jousselin (Plum- kett) va porter un toast, Rayer est
convoqué par son chef direct qui lui signifie sa mise à la retraite
d'office, avec le grade de lieutenant de vaisseau (20 octobre 1896).
Premier « coup de sabre
» de l'amiral Besnard, ministre de la marine. Un cyclone balaie
Rayer et sa famille. Des lettres indignées affluent. C'est Loti, qui
écrit : « Pardonne-moi, pauvre ami, de n avoir pu répondre dans le
premier moment de révolte et petidant que j'étais à Paris, remuant
ciel et terre pour essayer d'empêcher l'iniquité et l'ineptie de ces
vieillards. Ma vie est bouleversée d'une façon infiniment
douloureuse ; ma mère était ce que j'aimais le plus au monde et son
départ me laisse une détresse infinie. . . ». Sans doute Loti
prévoyait-il qu'il serait lui-même victime de ces mêmes vieillards.
A son tour, il fut mis à la retraite d'office le 15 avril 1898.
Peu après, il écrivait
à Emile Duboc : « Ah ! combien il se serait indigné, lui, l'amiral
[Courbet] , s'il avait pu prévoir que certains de nos chefs du
ministère, dans l'excès de leur traditionnel favoritisme pour les
fils et les gendres, amèneraient à force d'injustices, un officier
tel que vous [Duboc'] à quitter la marine. Et Duboc, le héros
désillusionné de Shaï-Pao, répond : « Je suis bien peiné, je
t'assure, de la mesure inique et ignoble dont tu es victime, comme
quelques-uns de nos camarades dont Sentis qui avait été blessé
grièvement au combat du Pont-de-Papier et à qui on a donné la même
récompense qu'à toi, dans les mêmes circonstances ; ce sont des
infamies. »
Rayer ne put se
pourvoir en Conseil d'Etat, parce que lui manquaient les 500 francs
(or) nécessaires ; il adressa au Président de la République une note
qui demeura sans effet. Mais sa riposte ne se fit pas attendre. Ce
fut d'abord une série d'articles dans l'Echo de Paris (journal
avancé, à l'époque) contre les abus de la Marine ; articles dans
lesquels Rayer se révélait un virulent polémiste à la manière
d'Henri Rochefort.
Ce fut ensuite un livre
savant et quasiment prophétique : L'Avenir de la torpille et la
guerre future, dans lequel on peut lire : « La guerre déclarée, nos
escadres seront immobilisées ; une nuée de torpilleurs, de
canonnières lançant des projectiles à haut explosif et quelques
sous-marins pourront Lettre inédite de P. Loti, Archives de M.
Guierre, Préface de P. Loti à « 35 Mois de Campagne en Chine et au
Tonkin » par Emile Duboc, seuls empêcher l'ennemi de ravager
impunément nos ports ». Et encore ceci : « Les héros d'autrefois
s'escrimaient à grands coups d'estoc et de taille et buvaient
parfois à la même coupe après des heures de combat acharné. Demain,
les preux du passé seront remplacés par des potards. Qu'avez-vous à
reprocher au ballon employé comme engin destructeur ? N'est-il pas,
avec la Withehead qui coulera au besoin un paquebot, avec l'emploi
des gaz délétères qui asphyxieront un bataillon comme on asphyxie
les chiens en fourrière, le triomphe de la guerre scientifique ? »
(écrit en 1898). De tout cela, la rue Royale prit d'abord ombrage;
mais de nouveaux chefs — dont le commandant Darrieus, grand ami de
Rayer — furent appelés aux leviers de commande.
Et Rayer obtint une
première réparation avec la rosette de la Légion d'Honneur (30 ans
après avoir reçu la croix pour faits de guerre !) Méditez cela,
candidats trop pressés, et ceci encore : Duboc, bien qu'ayant reçu
la croix et la rosette, à six mois d'intervalle et à 28 ans, des
mains de l'amiral Courbet, et pour quels exploits ! mourut à plus de
80 ans, sans avoir été promu commandeur.
Puis Rayer fut nommé
trésorier des Invalides et bientôt pilote-major — réparation, sans
doute, mais aussi habile moyen de paralyser sa plume de polémiste —
n'avait-il pas sept enfants à élever ? Car un septième était né, une
fille, dont Pierre Loti sera le parrain, ce qui valut au curé de
recevoir à la sacristie l'illustre écrivain et de faire signer à ce
protestant le livre d'or de l'église. Mme Rayer, elle aussi, était
émue à l'idée de recevoir l'académicien à sa table ; on sortit de
vieilles bouteilles, le menu comporta une énorme sole, ramenée des
grands fonds par les pilotes du commandant, mais Pierre Loti déclara
vouloir se contenter d'un œuf à la coque et d'un verre de lait.
Rayer écrivit des Souvenirs pour lesquels il demanda une préface à
Pierre Loti. Celui-ci accepta volontiers mais, pour ce qui était de
trouver un éditeur, se récusa, alléguant que ceux-ci étaient plus
préoccupés de commerce que de littérature. Ne lui avaient-ils pas
déjà refusé plus d'un manuscrit excellent qu'il eût été fier d'avoir
écrit ?
Le livre de Rayer
demeura donc inédit, mais point la préface que Loti publia après la
mort de son ami. Une longue maladie devait avoir raison du
tempérament « tout acier » de Rayer dont les dernières lignes qu'il
écrivit furent celles-ci : « J'en ai fini avec les aventures... Ma
fin de carrière eût pu être plus brillante, mais je ne regrette
rien, ni les honneurs, ni la fortune. J'ai toujours marché droit
devant moi, la tête haute. Je m'en irai la conscience tranquille. »
Il s'en alla peu après, porté en terre par ses vieux pilotes. Sept
enfants accompagnaient son cercueil, sept dont cinq fils. Bien qu'il
n'eût rien fait pour les y pousser, quatre d'entre eux entrèrent
dans la marine — et si le cinquième ne les y suivit pas, c'est qu'il
préféra s'engager comme fantassin en 1915. Les cinq — dont un, mort
pour la France — reçurent tous la Légion d'Honneur, trois furent
commandeurs. Par eux s'est perpétué l'idéal de « Droit devant », cet
homme qui, bien qu'on l'eût dit « terrible », laissa parmi les
anciens de notre marine un souvenir fait d'amicale et respectueuse
admiration.
Alors qu'il était
simple lieutenant de vaisseau, le vice-amiral Merveilleux du Vignaux
avait osé demander au ministre Pelletan le rétablissement des
aumôniers de la marine. Et, beaucoup plus tard, quand il voulut
prendre pour aide de camp un des fils de Rayer, il s'entendit
objecter : « Avez-vous donc oublié quel vieux radical était son père
? » — « Rayer ? un grand honnête homme », rétorqua l'amiral. Lorsque
l'amiral Lacaze, qui avait été aide de camp de l'amiral Besnard,
nous parlait de Rayer, il ne manquait pas d'ajouter : « Quel homme
extraordinaire il fut ! » Tant il est vrai qu'à la longue, la
droiture est tou- jours admirée ; plus particulièrement dans notre
marine où toutes les divergences idéologiques s'effacent devant la
loyauté et le courage. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à évoquer
un passé que j'ai vécu et un drame familial qui assombrit mon
enfance ; car celui qu'on avait surnommé « Droit devant » et que
Loti appelait « le terrible Rayer », cet homme « plein de verve et
de gaîté, aux qualités de cœur exceptionnelles, cet homme sûr pour
toute mission difficile » ne fut autre que mon père.
Maurice Guierre.
Capitaine de vaisseau
honoraire Ex-Vice-président de la Société des Gens de Lettres.
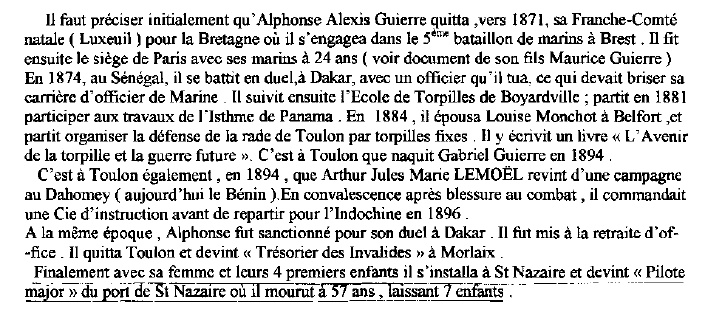

Amiral Darrieus -
parrain de Gabriel Guierre
Remerciements Documents et photos à Alain Guierre
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|