| -
Officiers et anciens élèves -
Dominique Jean LARREY
(1766 - 1842)
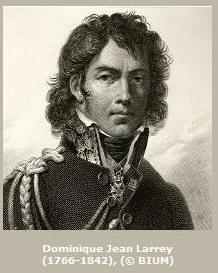
La « Providence du
soldat », surnom qu’il reçoit en Egypte, naît à Beaudéan, le 7
juillet 1766.
A 14 ans, son père
venant de décéder et sur la recommandation de l’abbé Grasset qui l’a
pris en charge, il quitte le domicile familial, et rejoint son oncle
Alexis, chirurgien en chef de l’hôpital la Grave de Toulouse, qui
lui enseigne la médecine pendant 6 ans, après avoir suivi une
scolarité au collège de l’Esquille des Frères de la doctrine
chrétienne (Vayre & Ferrandis, 2004). En 1785, il obtient le premier
prix de la Société Saint-Joseph de la Grave et est désigné «
professeur-élève » (Gourdol, 2010). Au concours d’aide-major, en
1786, il arrive majeur de sa promotion. Il soutient aussi cette
année-là, une thèse sur La carie des os. Il reçoit la médaille de
vermeil de la cité de Toulouse (Vayre & Ferrandis, 2004). Il gagne
la capitale et suit les cours de Dessault à l’Hôtel-Dieu.
En 1787, il intègre
l’école navale de Brest, puis embarque sur la Vigilante, après avoir
obtenu un concours de chirurgien major dans la marine royale, où il
a été classé premier.
De retour d’un voyage
jusqu’à Terre Neuve, l’équipage est au complet. Il apprend à y
travailler vite et bien, dans un local exigu. Sujet au mal de mer,
il demande son licenciement de la marine (Vayre & Ferrandis, 2004).
De nouveau à Paris, il suit une fois de plus les cours de Dessault
et de Sabatier, ce qui l’amène à être reçu premier au concours
d’aide-major de l’hôpital des Invalides en 1789. Il est écarté du
poste au profit d’un autre qui avait les faveurs du gouverneur.
C’est à cette époque qu’il devient très ami avec Corvisart et
Bichat. En 1789, il participe à la prise de la Bastille avec les
étudiants de l’école de chirurgie. En 1791, devenu chirurgien, il
s’occupe de soulager les blessés du Champ-de-Mars. En 1792, il
rejoint l’armée du Rhin au grade de chirurgien aide-major, où, dans
un premier temps sous les ordres de Percy, il parvient, par son
courage, à occuper des fonctions similaires aux siennes (Dupont,
1999). En 1792, à la bataille de Spire, véritable baptême du feu, il
applique sur le terrain, les préceptes de la chirurgie navale (
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr, sans date). Il réalise
d’ailleurs sous le regard attentif de Coste, Sabatier et Parmentier,
trois inspecteurs généraux du service de santé, une désarticulation
de l’épaule sur l’un de ses blessés (Lemaire, 1992 & 2003). Pendant
les périodes de repos, il transmet son savoir à d’autres médecins.
Ainsi, créée-t-il un cours de perfectionnement à Mayence en 1793 (Meylemans,
2010). Il milite activement pour que le médecin se porte au devant
du blessé. Sa conviction est profonde au point qu’il créée un corps
de brancardier et d’ambulancier, mais aussi, l’ambulance volante à
cheval qui sillonnent les champs de bataille dans toute l’Europe à
partir de 1797, puisqu’il l’instaure pendant la campagne d’Italie.
Larrey en revendique la paternité (Lemaire, 1992 & 2003).
En 1794, il est promu au rang de chirurgien en chef de l’armée de
Corse stationnée à Toulon. Cette même année, son projet d’ambulances
volantes est approuvé par le conseil de santé (Vayre & Ferrandis,
2004). De retour à Paris, il doit en partir précipitamment pour
éviter une possible arrestation. Il rejoint Toulon et c’est dans
cette ville qu’il rencontre pour la première fois Bonaparte.
En 1795, il devient professeur à l’école de santé du Val-de-Grâce où
il enseigne l’anatomie et la médecine opératoire (Gourdol (2010)
affirme qu’il s’agit d’anatomie et de chirurgie militaire et qu’il
est le premier nommé à cette nouvelle chaire), sous les ordres de
Coste qui la dirige. Il devient aussi chirurgien en chef de
l’hôpital du Gros-Caillou et des Invalides (Dupont, 1999). De 1796 à
1797, il est présent à tous les combats de la campagne d’Italie.
Napoléon salue chaleureusement son dévouement et surtout, l’esprit
d’organisation que le médecin a insufflé au service de santé.
Lorsque Bonaparte part pour l’Egypte en 1798, il prend le poste de
chirurgien en chef du contingent militaire en partance. Pourtant, à
la création de l’Institut d’Egypte, Larrey n’y siège pas. Les
médecins de la section de physique et de science naturelle
débattent, cherchent et émettent des mémoires faisant la synthèse de
leurs trouvailles. Les sujets portent notamment sur l’hygiène,
l’alimentation ou les épidémies. Ainsi, en est-il de Larrey qui
publie plusieurs traités qui établissent sa réputation scientifique
jusqu’en France où ses travaux sont reconnus (Marchioni, 2003).
Larrey créée une école pour les jeunes chirurgiens de l’armée. Il
combat le tétanos et la peste lors de l’expédition en Syrie. Il
comprend alors toute l’importance de l’hygiène des troupes (Vayre &
Ferrandis, 2004). Il réforme son ambulance volante. Les blessés sont
donc évacués à dos de chameau. Au départ de Bonaparte, il décide de
rester avec Kléber pour soigner ses malades et ses blessés (Dupont,
1999).
Larrey est élu au sein de l’Institut, le 4 juillet 1799, dans la
section de physique. Dans la même année, il publie son mémoire de 38
pages intitulé Mémoire sur le tétanos traumatique consécutif à
l’observation des blessures engendrées par les projectiles turcs,
qui fait grand bruit. En 1798, sans en être membre, il avait fait
paraître son Mémoire sur l’ophtalmie endémique en Egypte qui avait
déjà été consacré (Marchioni, 2003). En 1800, c’est autour du
Mémoire sur la fièvre jaune, considérée comme complication des
plaies d’arme à feu de paraître. Suivent de hepatitis et L’atrophie
des testicules. En 1801, il autopsie le corps de l’assassin de
Kléber, l’embaume et le fait exposer au Musée d’histoire naturelle (Marchioni,
2003). Il aurait embaumé le corps de Kléber également. A Canopée,
Larrey ramène un blessé sur ses épaules jusqu’à l’ambulance, ce qui
sidère tout le monde (Vayre & Ferrandis, 2004). Lors de la
reddition, Menou parvient à négocier avec les Anglais, la
conservation des archives, mémoires et collections amassées en
Egypte, qu’il ramène en France (Beaucour, 1970). Larrey, notamment,
conserve ses notes qu’il destine à publications dès son retour en
France et ses collections de crânes, et de momies (Marchioni, 2003).
A son retour d’Egypte, Larrey fait connaître un mémoire sur
l’Ophtalmie endémique. Il rencontre le futur Napoléon, en mars 1802.
Il lui présente sa Relation chirurgicale de l’expédition d’Orient
qu’ému, le Premier Consul reçoit et transmet aussitôt à son
secrétaire en lui ordonnant de le publier dans la Description
d’Egypte (Marchioni, 2003). Dans cet ouvrage, il publie aussi en
1809, un « Mémoires et observations sur plusieurs maladies qui ont
affecté les troupes de l’armée française pendant l’expédition
d’Egypte et de Syrie et qui sont endémiques dans ces deux contrées »
(Etat moderne, tome 1, pp. 427-524), et en 1812, une « Notice sur la
conformation physique des Egyptiens et des différentes races qui
existent en Egypte, suivie de quelques réflexions sur l’embaumement
des momies » (Etat moderne, tome 2, pp. 1-6) (Viel & Fournier,
1999).
En 1800, il officie en tant que chirurgien de la garde consulaire et
de l’hôpital de la Garde. En 1803, il soutient aussi sa thèse de
médecine qui porte le titre : « Amputation des membres à la suite
des coups de feu ( http://www.cheminsdememoire.gouv.fr, sans date).
» Il devient le premier docteur en chirurgie (Vayre & Ferrandis,
2004).
En 1804, nouvelle promotion. Il est chirurgien en chef de la Garde
impériale. Il opère en première ligne, au front, quelque soit le
temps. Il est omniprésent (Dupont, 1999 ; Meylemans, 2010). En 1804,
il est fait officier de la Légion d’honneur par le futur Napoléon et
est décoré en l’église des Invalides (Vayre & Ferrandis, 2004).
En 1805, à Ulm, Echingen et Austerlitz, tous les blessés sont opérés
sur le terrain. Les ambulances volantes sont d’une efficacité
exceptionnelle. Cette même année, il devient inspecteur général du
service de santé (Gourdol, 2010).
En 1806, à Iéna, Larrey instaure la sélection des blessés en
fonction de la gravité de leur état, mais mis en réserve avec la
Garde impériale, il ne participe pas au combat pour la seule et
unique fois de l’épopée napoléonienne (Vayre & Ferrandis, 2004).
Cette année-là, il préside à la Société de médecine de Paris dont il
est membre depuis sa fondation en 1796 (Vayre & Ferrandis, 2004 ;
Gourdol, 2010).
En 1807, à Eylau, il effectue 800 amputations en trois jours (
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr, sans date). Il est élevé au
rang de commandeur de la Légion d’honneur. Napoléon lui remet ses
insignes et son épée personnelle, directement sur le champ de
bataille. En 1807, de retour à Paris, Larrey reprend ses fonctions
de chirurgien en chef de l’hôpital de la Garde. Arrivé en 1808, sur
le sol espagnol, il demande, à Valladolid, la création d’un hôpital
pour l’ennemi, ce qui constitue une première (Gourdol, 2010). En
mars 1809, il doit s’aliter et de fait, rentre à Paris (Vayre &
Ferrandis, 2004). En 1809, à Essling, il ampute le général Lannes
qui décède 8 jours après. A Wagram, il opère 1 200 blessés et
pratique 300 amputations. 45 seulement décèdent. Napoléon en fait un
baron d’Empire et lui attribue une rente annuelle de 5 000 francs (Vayre
& Ferrandis, 2004). Il utilise le froid pour anesthésier ses
patients et entreprend de les évacuer aussitôt que possible pour
éviter les infections de leurs plaies. Il écrit à sa femme cette
année-là : « Plus de 10 000 blessés sont passés dans nos ambulances,
j’ai mis cinq jours et cinq nuits à opérer et à faire les pansements
d’urgence… (Lemaire, 1992 & 2003)»
Le 12 février 1812, il succède à Heurteloup au poste de chirurgien
en chef de la Grande Armée. Il brille particulièrement lors de la
campagne de Russie. Il ampute 200 hommes en un jour, lors de la
bataille de la Moskova, dont une en moins de deux minutes. Pendant
toute la durée de la campagne, il tient un journal d’une précision
extrême (Dupont, 1999). A Moscou, pourtant, Napoléon lui reproche de
ne pas avoir su « administrer sa partie (Lemaire, 1992 & 2003). »
Après le passage épique de la Bérézina, Larrey rejoint Konigsberg,
le 21 décembre. Il est atteint de typhus. Grâce aux soins d’un bon
médecin,
Alors qu’une place se libère à l’Institut, il choisit de laisser
Percy y être élu à sa place. Il intervient personnellement auprès du
tsar Alexandre I er pour qu’il rende sa liberté à Desgenettes en
1813, après qu’il ait été capturé. En 1813, il parvient à sauver 2
632 jeunes soldats, nouvelles recrues, du peloton d’exécution
ordonné par l’Empereur lui-même, alors qu’ils sont convaincus de
blessures volontaires, ceci à Lützen et à Bautzen où il réalise là,
ce qui est considéré comme la première expertise médico-légale (
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr, sans date). Larrey démontre au
sein d’un jury de chirurgiens et d’officiers supérieurs, avec une
telle conviction qu’il s’agit de blessures involontaires par manque
d’expérience, que Napoléon accepte de revenir sur sa décision (Vayre
& Ferrandis, 2004). De mauvaise humeur, malgré tout, l’Empereur lui
donne l’accolade à l’issue de cette affaire.
Lorsque Napoléon abdique, Larrey décide de l’accompagner en exil,
mais l’Empereur refuse estimant qu’il sera plus utile auprès des
soldats de la Garde (Vayre & Ferrandis, 2004). Lorsque Napoléon
revient en France, après d’être échappé, Larrey l’attend fidèlement.
Pourtant, c’est Percy qu’il nomme au poste de chirurgien en chef de
la Grande Armée (Marchioni, 2003).
Au cours de la bataille de Waterloo, alors qu’il est au feu à
récupérer et soulager les blessés, Wellington l’aperçoit, et fait en
sorte que la zone où le chirurgien se trouve ne soit plus menacée
par les tirs de ses hommes. Blessé et capturé, il est à deux doigts
d’être exécuté, mais reconnu, Blücher, reconnaissant que Larrey ait
sauvé son fils en 1813, le raccompagne à Louvain (Dupont, 1999).
Après une inspection des hôpitaux de Bruxelles, il gagne Paris qu’il
rejoint le 15 septembre 1815 (Vayre & Ferrandis, 2004).
Sous la Restauration, il devient chirurgien de la Garde royale après
avoir été tout de même quelque peu inquiété (
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr, sans date). En 1815, il est
question de le déchoir de son poste hospitalier, ce qui constitue
une mesure très grave. Il rédige un rapport faisant le bilan de sa
carrière qui est remis à la Commission d’examen qui doit statuer sur
son sort (Marchioni, 2003). Il est lavé de tout soupçon et maintenu
dans ses fonctions, le 27 novembre 1815. Toutefois, il ne perçoit
qu’une demi-solde. Il ne recouvre l’intégralité de sa pension qu’en
1818 (Marchioni, 2003). Il est élu à l’Académie de médecine, à sa
création, en 1820, à l’Académie des sciences en 1829, 25 ans après
sa première candidature, où il succède à Pelletan (Lemaire, 1992 &
2003).
De 1826 à 1836, il est professeur à l’Ecole militaire du
Val-de-Grâce (Meylemans, 2010 ; Gourdol, 2010).
Lors de la révolution de 1830, il est encore chirurgien en chef de
l’hôpital du Gros-Caillou. Il soigne les blessés des émeutes de
juillet 1830. Il s’interpose et refuse de livrer ses patients (Vayre
& Ferrandis, 2004).
Il est promu chirurgien en chef de l’hôtel royal des Invalides en
1831, après avoir réintégré sur ordre de Louis-Philippe, le Conseil
de santé (Vayre & Ferrandis, 2004). En 1832, il structure le service
de santé belge, à la demande du roi des Belges. En 1835, il lutte
contre le choléra lors de l’épidémie qui prolifère à Marseille.
Devenu autoritaire, impatient et intolérant, il est missionné à
l’étranger pour l’éloigner, puis mis à la retraite en 1838 (Vayre &
Ferrandis, 2004). Il en conçoit une profonde amertume. Il n’exerce
plus alors qu’en privé (Meylemans, 2010). Affublé de son uniforme de
Wagram, il est enfin évidemment présent lorsque les cendres de
Napoléon sont rapatriées en France, en 1840.
Le 25 juillet 1842, il décède à Lyon, alors qu’il revient d’une
tournée d’inspection harassante des hôpitaux d’Algérie. Sa femme
était morte quelques jours auparavant sans qu’il le sache. Le 8 août
1850, est inaugurée au Val-de-Grâce, uns statue de Dominique Larrey
sculptée par David d’Angers (Vayre & Ferrandis, 2004). Une autre a
été érigée à l’Académie nationale de médecine en 1856. Une troisième
enfin existe à Tarbes. Ses cendres ont été transférées du
Père-Lachaise aux Invalides en 1993 selon Dupont (1999), en 1992,
selon Gourdol (2010). Son nom figure sur la 30 ème colonne pilier
sud de l’Arc de Triomphe (Meylemans, 2010 ; Gourdol, 2010).
Il a été présent lors de toutes les campagnes de la Grande Armée :
soit 25 campagnes, 200 affrontements, 40 batailles, 6 fois blessés
au feu (Marchioni, 2003).
Humaniste confirmé, il ne compte pas son temps et n’économise jamais
son énergie au service des blessés, qu’ils soient amis ou ennemis
d’ailleurs, peu lui importe. Napoléon le porte au plus haut dans son
cœur et dans son estime. Il dit de lui, à Sainte-Hélène, avant de
mourir, dans son testament où il lui lègue notamment la somme de 100
000 francs : « C’est l’homme le plus vertueux que j’aie connu. Il a
laissé dans mon esprit l’idée du véritable homme de bien (Lemaire,
1992 & 2003 ; http://www.cheminsdememoire.gouv.fr, sans date). » A
Essling (1809), il n’hésite pas un seul instant à faire tuer ses
propres chevaux pour en faire du bouillon qu’il donne à ses patients
(Dupont, 1999).
Il n’a jamais été, à son grand regret, professeur à la Faculté de
médecine de Paris, car, semble-t-il, Desgenettes et Percy ont fait
en sorte de rendre ce pieux rêve inaccessible (Lemaire, 1992 &
2003). Il a postulé à 5 reprises pour des chaires diverses, mais ses
candidatures ont toutes été rejetées. Il a essayé de créer deux
écoles de chirurgie, une à Madrid et une à Varsovie. Les deux
projets ont malheureusement avorté (Lemaire, 1992 & 2003).
Les soldats de la Grande Armée le vénèrent. Alors sur le point de
mourir, ils le sauvent au passage de la Bérézina, l’accueillent aux
bivouacs, le réchauffent et le nourrissent.
Larrey n’hésite pas à faire acte d’héroïsme. Comme en 1814, à la
ferme d’Heurtebise où une ambulance sans protection est menacée par
les cosaques, le médecin charge sabre au clair pour sauver 200
blessés (Vayre & Ferrandis, 2004).
Sa pratique de l’amputation lui a permis de sauver plus de 75 % de
ses blessés, mais surtout a évité la propagation du tétanos (
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr, sans date).
Il s’est toujours insurger contre la corruption chez les
commissaires et au sein de l’administration du service de santé. Il
n’hésitait pas à aller réveiller des généraux, la nuit pour obtenir
des fournitures et était craint parce qu’il ne faisait la cour à
personne. Tout le monde savait que, s’il n’obtenait pas ce qu’il
voulait, c'est-à-dire le mieux pour ses blessés, il irait tout droit
chez l’Empereur pour faire valoir ses récriminations (Vayre &
Ferrandis, 2004).
Dès l’âge de 19 ans, il avait été initié à la franc-maçonnerie (Vayre
& Ferrandis, 2004 ; Gourdol, 2010).
Source Web

Autres informations / Source Web
Retour Officiers
et anciens élèves
|