| -
Grand C
-
1°
« CHAPITRE XI
FÊTES ET TRADITIONS

Voir
PDF
Malgré le nombre considérable des cours et des exercices, la vie du
Borda est un peu monotone, et, de tout temps, les élèves ont
recherché avec empressement les occasions d'entremêler leur
existence studieuse de quelques moments de distraction. Nous avons
déjà, au cours de cet ouvrage, décrit quelques-unes des traditions
en honneur de l’École navale.
Nous avons vu, dès le premier Jour de la rentrée, les anciens
accueillir l'arrivée des fistots au réfectoire par un roulement
d'assiettes, accompagner le commandant lors de son départ de
l'École, faire la remise des sabres.
Nous avons aussi vu les fistots rendre les honneurs au cabaret du
« Grand Turc », et convoyer la corvette d'honneur des anciens à
l'époque des examens de fin d'année. Mais là ne se bornent pas les
traditions de l'École dont la plus fameuse est la fête du C.
C est le chiffre algébrique correspondant au numéro matricule le
plus élevé de la promotion. Au début de l'année scolaire, on divise
par ce numéro le nombre de jours que la promotion doit passer à
l'École, et on obtient ainsi un quotient servant à établir le
calendrier spécial du Borda. Ainsi les élèves ayant 630 jours
à passer à bord et le numéro matricule le plus élevé de la promotion
étant 178, on divise 630 par 178, ce qui donne 3 au quotient, plus
un reste égal à 96.
Le calendrier sera donc ainsi établi :
Le temps de séjour à bord = 3 x 178 + 96 ou 3 C + 96.
C’est là ce que l'on appelle l'équation du C, inscrite sur le
tableau noir de la batterie.
Chaque jour passé diminue le reste d'une unité et lorsque ce reste
devient égal à zéro, on célèbre la fête dite du petit C.
Cette fête consiste dans une distribution de vin chaud faite par
l'administration et par l'offre, le soir, à chaque table d'anciens,
d’un superbe gâteau, don de la table correspondante des fistots.
En retour, le major des anciens lit, à la récréation qui suit le
souper, l'histoire suivante aux fistots attentifs et recueillis :
« Jadis, par delà les âges et les siècles accumulés, Jupiter venait
de finir une vaste coupe de nectar et, plongé par cette divine
boisson dans une douce quiétude, il s'était mis à rêver. Depuis
quelque temps, certaine chose manquait à son bonheur, car, ayant
passé en revue les innombrables sujets de son empire, il avait
trouvé une lacune, et cette lacune, il ne savait comment la
combler !
« Mais, ce jour-là, le nectar l'aidait dans ses réflexions
laborieuses. Aussi, le père des dieux releva-t-il tout à coup,
brusquement, la tête, et il se mit à rire à la façon homérique des
immortels.
« Eureka ! s'écria-t-il, Eureka ! Je sais ce qui
manque à la multitude de mes héros, « de mes fidèles, de mes
enfants ! Ce sont des bordaches. Désormais, je veux avoir « des
officiers de marine sur l'océan du ciel. »
Ce qui fut dit fut fait et, quelques jours après, un ponton, en tout
pareil à celui qui nous porte encore aujourd'hui, tanguait doucement
sur les flots houleux de la rade olympienne. Le Borda céleste
ne tarda pas à prospérer et devint bientôt très florissant. Jupiter
adorait ses jeunes élèves, il les choyait, leur accordait tout ce
qu'ils demandaient. C'étaient, tous les jours, des flots de vin
chaud, des torrents de punch, des avalanches de pudding au rhum.
C'étaient d'interminables libertés de manœuvre, des sorties
continuelles, des congés à n'en plus finir, des réjouissances
échevelées et jamais de punitions, jamais de pelotons, jamais de
chibis. On n'avait jamais vu un Borda pareil et on n'en
verra probablement jamais plus !
« Hélas ! le sort malencontreux et jaloux avait jeté un regard de
travers sur cette heureuse existence. Un nuage sombre planait à
l'horizon des bordaches, et ce nuage ne tarda pas à crever. Un jour,
jour néfaste, Jupiter et sa tendre Junon, escortés de plusieurs
autres dieux, venaient d'embarquer dans leur canot, afin d'aller
faire une partie de fraises dans un coin paisible de la rade. Le
ciel était pur, la mer calme, et une brise folle jouait
paresseusement avec les cheveux de la brune déesse.
« Sur la dunette, quelques élèves regardaient l'embarquement
laborieux des provisions.
« L'un d'eux, poussé par quelque noir démon, osa lancer à Junon un
regard langoureux et mélancolique. Celle-ci, coquette, et flattée de
cet hommage rendu à ses charmes, lui répondit complaisamment.
« Hélas ! à cet instant, le père des dieux et des hommes leva la
tête et il surprit au passage les sourires donnés et rendus, et son
cœur en conçut, sur-le-champ, une formidable colère.
« Pourtant il sut se contenir et garder pour plus tard l’explosion
de son terrible, mais juste ressentiment.
« Le lendemain, le bordache précité, ne songeant plus à l'aventure
de la veille, prenait tranquillement une hauteur circumméridienne,
quand le timonier Mercure vint lui annoncer que Jupiter le
demandait. Sans quitter son fidèle sextant, le malheureux, flairant
quelque catastrophe, se rendit auprès du roi des dieux. Celui-ci
était sur son trône de gloire, ses yeux lançaient des éclairs sous
ses sourcils froncés, sa chevelure s'agitait sur son front
majestueux et sa main se crispait sur les foudres vengeresses
portées par Vulcain. Quand il vit entrer le bordache, il se leva
d'un bond si terrible que son aigle favori s'envola, en poussant un
cri de paon, et que tout l'Olympe en trembla: « Malheureux,
hurla-t-il d'une voix tonitruante, c'est ainsi que tu me récompenses
de mes bienfaits ! Comment ! je t'ai aimé comme mon fils, je t'ai
prêté l'appui « de ma toute-puissance, j'ai prévenu tes moindres
désirs, je t'ai fait une vie heureuse, et, pour prix de tout cela,
infâme, tu as osé jeter sur ma tendre épouse un « regard audacieux,
tu as osé lui sourire devant moi, son maître, et le tien ! Va-t'en,
« serpent, disparais, je te renie, je te chasse, je te maudis ! »
Et, ce disant, Jupiter s'élança et, brutal, il appliqua son pied
divin au bas des reins de l'infortuné bordache. Celui-ci, lancé
comme un obus de rupture par un canon de 42, partit avec une vitesse
initiale considérable, décrivit dans les airs une trajectoire
parabolique et, passant par-dessus la rembarde qui borde l'Olympe,
il fut précipité dans le vide.
« Ce fut une bien belle chute ! Pendant cent jours et cent nuits, le
malheureux, toujours muni de son sextant, dégringola à travers les
espaces interplanétaires. Il sauta par-dessus Sirius, fut salué au
passage par un sourire moqueur de Vénus, perdit un de ses bichons
qui resta accroché à l'anneau de Saturne, et faillit blinder Uranus.
Sur la terre, tous les observatoires étaient en émoi, car on croyait
qu'un astre nouveau avait fait son apparition sur la sphère céleste.
Les membres du Bureau des longitudes avaient déjà déterminé son
ascension droite et calculaient sa déclinaison. La Connaissance
des temps allait s'enrichir d'un habitant nouveau. Et cependant
le bordache continuait fla course vertigineuse à travers les astres.
Il était entré dans l'atmosphère de notre planète, et voyant,
au-dessous de lui, les objets se rapprocher peu à peu, il se disait
avec frayeur : « Gare la blinde ! »
« Et la blinde se produisit avec une vitesse de 123,456 nœuds, 789,
vitesse que les torpilleurs futurs n'atteindront jamais. Il tomba
sur un rocher. Le choc fut tel que le dur granit s'entrouvrit. Le
bordache le traversa comme une mince feuille de papier' et disparut
dans la mer. Il y eut un grésillement de pierres entrechoquées, un
tourbillon d'écume rebondissante. Une nuée de gargouillots, surpris
dans leur sommeil, s'enfuirent à grands battements d'ailes, avec des
cris effarés et aigus. Puis la mer redevint calme, ridée seulement
de quelques cercles ondulés qui allaient s'élargissant. « Le roc
fendu présente maintenant la forme d'une lettre, et cette lettre est
un C.
« Les bordaches célestes ont la vie dure. Au bout d'un moment, notre
héros, qui avait plongé à des profondeurs phénoménales et insondées,
remonta à la surface. Avec un geste de barbet, il secoua sa
chevelure humide et huma une grande lampée d'air frais, puis il
regarda autour de lui.
« C'était une rade immense, bordée par des rocs dénudés et tristes.
Une brume épaisse la couvrait, lugubre, masquant l'entrée étroite
près de laquelle il était tombé. Une sorte de tristesse morose
planait là-dessus, et la pluie fine qui tombait avec une monotonie
stupéfiante glaçait le cœur.
« Tout à coup, le bordache eut une exclamation de surprise. Vers le
Nord, il distinguait une forme vague, quelque chose comme un spectre
immense et fantastique de vaisseau. Il prit la lunette astronomique
de son sextant, qu'il n'avait pas largué, et il regarda.
« Il ne s'était pas trompé ! L'objectif de la lunette lui présentait
l'image renversée, mais très claire, de son ex-ponton, de ce
Borda qu'il avait quitté par une si jolie culbute.
« Aurait-il dégringolé avec moi? pensa-t-il. « Allons-y voir ! »
« Et, se débarrassant de son gris, qui lé gênait, il tira
méthodiquement sa coupe vers l'objet de son attention. Plus il se
rapprochait, plus le vaisseau spectre devenait visible. Il
apercevait déjà le buste doré qui surmonte la guibre ; il voyait sur
le ciel noir se détacher les mâts, les vergues, les haubans. Enfin
il arriva tout près. Plus de doute ! A un sabord, une tête
d'individu ramolli, abêti, abruti par des mois passés sur cette
baille, apparaissait, grimaçant un triste sourire devant deux
gargouillais qui se disputaient un morceau de sec. Le céleste exilé
reconnut immédiatement le type bordache. Chassé du ponton des
immortels, le malheureux tombait sur le ponton des humains !
« Il entama immédiatement une conversation par signaux à bras avec
les pauvres prisonniers, dont il se fit connaître, et ceux-ci, ravis
de l'occasion, l'accueillirent à bras ouverts. Bien plus, comme
l'anarchie et le désordre régnaient à bord, ils le nommèrent pape et
lui confièrent le soin de réorganiser leur ponton.
« Notre héros, élevé aux plus grands honneur, il se montra digne de
la confiance qu'on lui témoignait. Il commença par doter ses élèves
du fameux sextant, ce sextant sorti des mains divines du père
Antoine, le fabricant et fournisseur en titre de l'Olympe ; puis il
mit en vigueur l'ancien règlement du grand Jupiter.
« La joie, la gaieté, la tranquillité ne tardèrent pas à remplacer
l'ennui, le ramollissement et le dégoût. Le Borda terrestre
devint bientôt aussi prospère que sa succursale d'en haut. Les jours
s'y passaient sans soucis, sans inquiétude. C'était la plus paisible
des existences, comme le plus parfait des bonheurs.
« Or Jupiter, que sa haine pour son ancien subalterne n'avait point
abandonné, commença à s'irriter de ce succès croissant. La colère,
une colère sourde et féroce, lui monta au nez, et il se sentit
capable de frapper un grand coup. Un matin il dit adieu à sa tendre
Junon, cacha ses traits divins sous des dehors mortels, et, plein
d’une sombre idée de vengeance, il quitta l'Olympe et descendit,
dans un nuage, jusque sur le Borda d'ici-bas. Il se présenta
au pape, ce pape auquel il avait administré jadis, un si majestueux
coup de pied quelque part, et prétendit être envoyé par l'autorité
supérieure pour l'aider dans ses travaux. Il fut donc admis à
régenter dans ses détails le malheureux ponton. Hélas! au bout de
quelques jours, on reconnut que cet intrus n'était autre que le père
des dieux. Il était trop tard ! le mal était fait ! Comme Jupin
avait abandonné sa femme pour satisfaire son désir de vengeance, on
l'appela le Veuf, dont on fit plus tard la Veuve, et ce fut tout !
Le régime de la terreur était arrivé ! On vit bientôt surgir toutes
les horribles choses que la malice d'un cœur méchant est capable
d'inventer ! Le DX, l'Astro, la Carlingue, la Chafuste, les
ships, etc., etc., s'abattirent brutalement sur les infortunés
bordaches. Les chibis, antres immondes, se creusèrent
dans le faux-pont. Une nuée de chiens de garde, issus du cruel
Cerbère, firent irruption sur le Borda, prêts à déchirer, à
belles dents, tout ce qu'ils rencontreraient.
« Le céleste exilé, désespéré de cet état de choses, piqua une tête
au fond des flots et disparut pour toujours.
« Son sextant fidèle resta seul pour rappeler à la postérité le
souvenir de ses bienfaits.
« C'est aujourd'hui, fistots, que nous fêtons ensemble
l'anniversaire de la fameuse chute du héros de cette histoire. Que
cette solennité vous rappelle le respect dû au~ traditions, car
elles sont le lien intime qui unit, à travers les siècles, toutes
les promotions du Borda.
« Songez que la fraternité doit toujours régner entre vous et ceux
qui vous ont précédés ici. C'est l'accomplissement de ce devoir qui
fera votre force et le bonheur de votre avenir! »
Des applaudissements unanimes accueillent le récit de ce morceau de
prose fantaisiste, que nous avons recueilli avec soin, comme un
exemple original des discours prononcés, en certaines occasions, par
le major des anciens, aux fistots, mis ainsi peu à peu au courant
des singulières traditions de l'École.
Telle est la fête du petit C, surpassée en éclat et en réjouissance
par la fête du C, le grand, célébrée le jour où l'équation
journalière constate que les anciens n'ont plus que C jours à passer
à bord. Huit jours avant cette époque fatidique, les anciens
installent dans leur batterie le mannequin du C. ce mannequin
souffre-douleur de la promotion, est, par principe,
antiréglementaire dans tous ses détails.
Sa casquette est sale, ses cheveux sont longs et mal peignés.
Dédaigneux de toute tenue, de tout esprit de corps, il porte la
moustache, un faux-col, une cravate de couleur, et le col de sa
vareuse est tout petit. Il porte des souliers pointus à talons
plats, un pantalon extrêmement large du bas. Son gris est
couvert d'encre, de goudron, de boue. Ses poches sont terriblement
compromettantes. Elles renferment des allumettes, une montre, un
journal, un porte-monnaie contenant 51 sous, un de plus que ne le
permet le règlement, une bouteille d'eau-de-vie et du tabac ! Dans
sa falgue il cache un mouchoir de civil, et un roman dissimulé au
moyen de la couverture du livre réglementaire : la Vie de Nelson.
Il est là, emportant avec lui la honte des fautes commises par la
promotion. Il tend humblement sa main, gantée de couleur, autre
crime ! et il compte sur la générosité des professeurs pour réunir
ses 51 sous. Enfin le grand jour arrive.
En sortant de classe, à quatre heures de l'après-midi, toutes les
issues menant au pont sont soigneusement fermées, les capots sont
mis aux panneaux et les fistots consignés dans lem batterie. Chaque
sabord est gardé par un ancien pour prévenir toute indiscrétion des
fistots. Chaque ancien est orné de lettres C, en carton ou en
papier, suspendues aux oreilles, dans le dos et autour du cou.
L'élève dont le matricule correspond au C monte, entre deux
gardiens, son ami et frère le mannequin, qui, le matin encore, à
l'inspection, s'est fait réprimander par le capitaine d'escouade et,
dans la journée, s'est fait signaler pour faire de la chafuste à
l'étude forcée de manœuvre. Le mannequin est reçu sur la dunette par
le major de la promotion et le jugement commence. L'accusateur
public prend la parole. A chaque nouvelle faute signalée par lui, un
cri général s'élève : La cale ! La cale !
Pas de grâce possible.
C'est en vain que l'avocat de l'accusé plaide les circonstance~
atténuantes.
Il faut que le coupable soit pendu, la hart au col, à la grande
antenne de la nef eschole, et comme, en somme, il est ancien, on
lui fait les honneurs du tentard. On lui passe un cartahu au cou,
et, par trois fois, on le hisse à bout de la grande vergue et on le
laisse, par trois fois aussi, retomber dans la mer. A la troisième
fois, le filin cède et le C s'en va au fil de l'eau, emportant avec
lui son oignon d'argent, ses 51 sous, sa bouteille d'eau-de-vie et
une petite boîte contenant des lettres pour les professeurs. Ces
lettres présentent sa défense. C'est l'accusation de ses
accusateurs, c'est l'histoire de la chaîne fatale qui l'a mené à sa
perte. Mais un obligeant youyou repêche le supplicié et pendant que
les sauveteurs se partagent ses dépouilles, les lettres trouvées sur
lui sont remises à leur adresse et servent à édifier les officiers
et professeurs sur les sentiments intimes des anciens, au sujet de
la vie du bord. Aussitôt l'exécution terminée, les anciens forment
un monôme, celui qui est en tête portant un vieux sextant en bois,
surnommé Antoine, et tous descendent dans la batterie des fistots en
chantant d'un air lugubre : « Tu t'en vas et tu nous quittes ! ...).
A près avoir fait deux fois le tour de la batterie, le monôme
remonte sur le pont, et les anciens se groupent autour du vénéré «
Antoine ».
Les fistots réunis face à leurs camarades écoutent religieusement le
major des anciens qui leur révèle les mystères cachés du sextant. Le
discours fini, chaque fistot vient s'agenouiller devant le vénérable
instrument placé, comme une relique, sur un pliant et ayant pour
socle une Connaissance des temps et une Table de
logarithmes. Il s'incline profondément, baise respectueusement
l'alidade d'Antoine, après s'être purifié les lèvres en crachant
dans un crachoir disposé à cet effet.
La cérémonie terminée, Antoine est reporté
processionnellement dans le bureau du C, où il reste jusqu'à l'année
suivante.
Le soir, la fête se termine par une distribution de vin chaud et de
gâteaux.
Désormais le règne des éléphants commence.
On est à C - 1. Cette année, à C - 178, les chrysalides seront
devenues papillons, les bordaches seront aspirants !"
Extrait de HISTOIRE DE L’ÉCOLE
NAVALE et des institutions qui l’ont précédé, « un ancien
officier » ; Paris : Quantin, 1889, p. 325-331.
2°
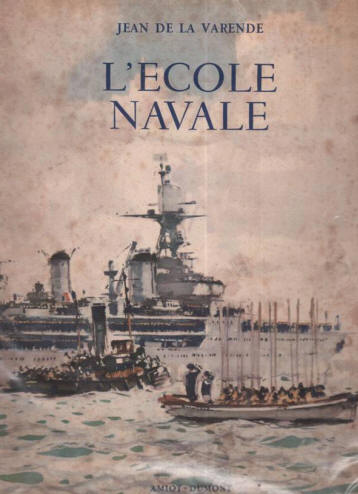
« Il faut dire un mot du C si connu
et si mal connu de tous ceux qu'intéressa l'École Navale. Le C,
littérairement
[sic pour
« littéralement »], c'est le
mauvais élève, une personnification de l'élève antiréglementaire. Il
porte une casquette sale sur des cheveux longs, laisse pousser sa
moustache, arbore une cravate de couleur ; son gris,
c'est-à-dire son carton, c'est-à-dire son vêtement de
treillis qui recouvre le veston de laine, est plein de taches où
domine le goudron. IL détient cinquante et un sous, dans son
gilet ; une montre, une fiole d'eau-de-vie et du tabac, avec un
roman pornographique. On n'a droit qu'à deux francs cinquante, la
montre est prohibée comme objet plus ou moins précieux, le tabac
doit rester aux cachihis, aux casiers de la dunette, car on ne fume
que sur le pont. C'est ainsi qu'on charge le mannequin qui
représente le C, huit jours sur avant sa fête, la fête du Grand C.
Pourquoi le C ? C'est le chiffre
algébrique correspondant au matricule le plus élevé de la promotion.
A l'arrivée, on divise par ce nombre le chiffre de jours que la
promotion doit passer sur le Borda, et l'on obtient ainsi la
constante : C.
Par exemple, les élèves ayant 630
jours à passer à bord, et le matricule le plus élevé étant 178, on
divise 630 par 178, ce qui donne 3 au quotient, avec un reste de 96,
le calendrier sera donc ainsi établi : Le temps de séjour à bord,
soit T = 3 x 178 + 96 (ou 3 C + 96).
On célébrera la fête du petit C après
96 jours, quand l'équation portée au tableau noir de la batterie
donne T = 3 C, et ce sera la fête du grand C quand elle ne donnera
plus que T = C, et qu'il ne reste donc que 178 jours à passer au
Borda.
Pour la fête du grand C, le mannequin
est monté sur 1a dunette, par le titulaire du matricule malheureux –
jadis un souffre-douleur – et le jugement du C commence. A chaque
crime énoncé par le rapporteur, les assistants hurlent : « La cale,
la cale ! », l'ancien supp1ice qu'on va renouveler pour le coupable
avec cette aggravation qu'il est pendu par le cou, lui, à la
grand'vergue.
De cette position élevée, on le
laisse choir par trois fois dans la mer ; à la troisième, le cartahu
cède : le C est à l'eau. Il est repêché, on visite ses poches ; on y
trouve en plus des objets incriminés, une petite boîte métallique et
étanche qui contient ses lettres personnelles d'excuses. Rédigées
avec art et malice, elles permettent aux officiers de se rendre
compte des griefs informulés par les élèves…
Le lendemain, au tableau noir : T -C
- l, pour le jour où T -C-178, libérera la promotion. »
Extrait de L’ÉCOLE NAVALE, Jean de la Varende, Amiot-Dumont,
Paris 1951, p. LVI.
3°
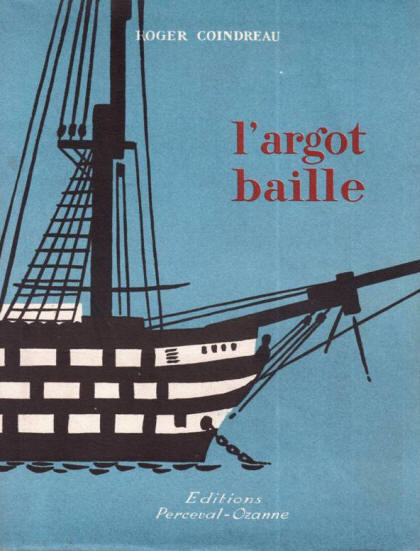
« C est le chiffre du numéro
matricule le plus élevé de la promotion des Anciens. L'élève qui
porte ce numéro est lui-même appelé le Grand C, tandis qu'au
contraire l'élève à qui est affecté le plus petit numéro matricule
(n° 1 ou n° 2, selon qu'il s'agit d'une promotion impaire ou d'une
promotion paire) est le petit C.
Au Borda, le chiffre C réglait
toute la vie « traditionnelle» de l'École, dont le calendrier
spécial était déterminé par l'équation du C.
Admettons, par exemple, que C soit
égal à 120 (cas d'une promotion paire de soixante élèves). Le nombre
de jours que les Anciens ont à passer à l'École avant la sortie -le
midshipat - (en principe le 20 juillet dans les dernières années du
Borda) est de 293 ou 294 (année bissextile), compte tenu du congé de
deux mois accordé à la fin de la deuxième année d'instruction. Ce
nombre s'exprime donc par : 2 C + S3. Telle est l'équation du C.
L'équation du C était également
utilisée par les Bordaches pour dater leur correspondance. Ainsi,
selon ce mode original, une lettre
écrite le 2 novembre 1910 par un
Ancien d'une promotion paire de soixante élèves, était datée : 2 C +
21. Les fistots, à qui il était interdit d'envisager leur sortie de
l'École, n'avaient théoriquement pas le droit d'employer à cet usage
particulier l'équation du C, mais ils éludaient fréquemment cette
consigne. Un élève de la promotion 1859 (C = 112) datait ainsi une
lettre du 10 novembre 1859 : 5 C + 68.
Quand le reste de l'équation du C
devient nul – au bout de 53 jours, dans le cas considéré plus haut –
c'est la date prévue pour la fête dite : tradi du petit C.
Dans les premières années de l'École
flottante, la fête du petit C comportait essentiellement un « souper
» (repas du soir) particulièrement soigné avec distribution de vin
chaud. A ce repas, chaque table d'Anciens recevait un superbe
gâteau, don de la table correspondante des fistots. En remerciement,
le major des Anciens, à la récréation qui suivait ce festin, lisait
aux fistots une histoire humoristique et fantaisiste sur les
origines de L'école Navale. (H.E.N.) [s.f.]
Ces rites se sont profondément
modifiés. A bord du dernier Borda, la tradi du petit C
comportait, encore après un dîner au menu alléchant, une soirée
récréative dite beuglant. (Voir ce mot.)
Quand il ne restait plus aux Anciens
à passer à l’École qu'un nombre de jours égal à C – équation du C
réduite à 1 C – avait lieu la tradi du Grand C, la plus
grande fête de l'École Navale, depuis ses origines jusqu'à nos
jours.
Si les détails de cette fête ont pu
évoluer avec le temps, les rites fondamentaux en sont restés
immuables pendant toute la durée de l’École embarquée.
Ce jour-là, un mannequin, à la
confection duquel les Anciens avaient mis tous leurs soins, était
exposé dans la batterie des Anciens. Il figurait le mauvais
élève-type, sale, débraillé, aux cheveux démesurés en broussaille,
indiscipliné, frondeur, batailleur, intempérant et, pour tout dire,
coupable de toutes les infractions aux règlements de l’École.
Au début de la fête, ce mannequin
était amené sur la dunette où, en ce grand jour, les élèves, à titre
exceptionnel, avaient librement accès. Encadré de deux factionnaires
– le plus grand et le plus petit des Anciens – il se trouvait soumis
à une parodie de conseil de discipline que présidait l'Ancien-major.
En présence des deux promotions assemblées et de l’État-major de
l’École, l'Ancien Grand C prononçait le réquisitoire, auquel
répondait un élève faisant office d'avocat. Réquisitoire et
plaidoirie, d'une débordante fantaisie, évoquaient avec esprit, et
souvent avec talent, les divers incidents de la vie de l’École au
cours de l'année écoulée. Naturellement, officiers, professeurs et
instructeurs y étaient plaisamment pris à partie par voie
d'allusions plus ou moins transparentes. Les manies et travers des
élèves étaient soulignés pour la plus grande joie de l'assistance.
Finalement le C était traditionnellement condamné à subir le
supplice de la cale. Le mannequin du C était alors hissé au
bout de la grand'vergue et, par trois fois selon la coutume, plongé
dans la mer parmi les cris et les exclamations joyeuses des élèves.
Pendant de nombreuses années, la fête
s'accompagnait, après le supplice du C, de l'adoration d'Antoine,
au cours de laquelle chaque fistot venait s'agenouiller devant un
sextant en bois. (Voir ANTOINE.)
Un beuglant clôturait
invariablement cette journée mémorable entre toutes.
Tel était le déroulement habituel de
la tradi du Grand C à l'époque du Borda.
Cette tradition a survécu au
transfert de l’École à terre mais elle dut être adaptée aux
conditions nouvelles de la vie des élèves. Il ne pouvait notamment
être question, dans une caserne, de faire subir au C le supplice de
la cale ! Donc, mise en accusation, défense et condamnation du C
disparurent. En fait, les rites de cette grande fête traditionnelle
se trouvèrent complètement transformés.
A Laninon, les élèves faisaient
éditer chaque année, à l'occasion de la fête du Grand C, une sorte
de programme, illustré et rempli « d'astuces» inspirées par les
événements de la vie quotidienne de l’École. Ce document rappelait
un peu la manière de L'Os à moelle de Pierre Dac, accommodée
à la sauce-Baille. Mais, pour bien marquer que « la tradition
continuait », ces programmes étaient présentés chaque année dans les
termes suivants, devenus rituels :
« Aux temps héroïques de la Baille
en bois, un malheureux, victime de son franc-parler, paya d'un
terrible mais juste châtiment quelques lettres indiscrètes sur les
sujets que l'on devine.
cc Dans sa bonté bien connue, la promo ..., ne voulant pas donner à ses
fistots ce spectacle terrible mais moralisateur et, désireuse
cependant de marcher jusqu'au bout dans le vertueux sentier tracé
par les promos précédentes, présente ... » Et, pour être plus
explicite encore, un dessin représentant le mannequin du C pendu à
bout de vergue figurait toujours sur les programmes. Ainsi la chaîne
n'était pas brisée !
Depuis le transfert de l’École à
terre, l'équation du C est tombée en désuétude. Il n'y a plus
de tradi du petit C et la tradi du Grand C se fête dans les
derniers jours que les Anciens passent à l’École, en général; le
jour de la remise du drapeau à la promotion des fistots.
A Lanvéoc, le Grand C consiste
essentiellement en un beuglant où, sous la forme d'une revue,
sont mis sur la sellette la plupart des officiers instructeurs, la
Veuve - Commandant en second – et le Directeur des études, en
tête. Seul, le Commandant – le Pape – par déférence, est tenu
en dehors de toute participation à la scène. Chaque acteur porte un
uniforme que lui a prêté l'officier qu'il doit représenter. Pour
préparer cette manifestation artistique, toutes les particularités,
tous les tics des officiers, toutes les phrases bizarres ou
originales prononcées par eux sont soigneusement notés au cours de
l'année. Le texte de la revue et sa mise en scène sont ainsi
préparés longtemps à l'avance.
Réduite à ces rites nouveaux, la
tradi du Grand C revêt encore une grande importance aux yeux des
Bordaches modernes. C'est toujours la fête principale de l'École
navale. »
L’ÉCOLE NAVALE ET SES TRADITIONS l’argot baille ;
Paris : Perceval-Ozanne, 1957 p. 91 – 95.
4°
« « C
(grand)
n.m.
1. Cérémonie (→ 3°
infra)
(auj. de fin d’année, où les
fistots,
moyennant quelques
initiations
pour parachever leur éducation, sont élevés à la dignité d’anciens).
Enc.
(Avant 1913) « le
C, littérairement [sic
pour littéralement !], c’était le mauvais élève, une
personnification de l’élève antiréglementaire [antiréglo],
qui se caractérise, entre autres par une tenue débraillée, »
« J’étais débraillé … je l’avoue »,
Chansons-Baille :
Vase du C, st. 4 v 3.
Il porte une casquette sale sur des cheveux longs, laisse pousser
ses moustaches, arbore une cravate de couleur : son
gris,
c’est-à-dire son
carton
(vêtement de treillis qui recouvrait le veston de laine), était
plein de taches où domine le goudron. Il détenait cinquante et un
sous, dans son gilet « Dans ma poche, j’ai toujours eu / 2 fr. 50,
et un sou d’ plus, / Une montre et une boîte d’allumettes » ,
CB :
Vase du C, st. 3 v. 1-3–
une montre, une fiole d’eau-de-vie (sextant),
interdit par le règlement et du tabac, avec un roman pornographique.
On n’avait droit qu’à 2,50 francs (50 sous pour les non-initiés), la
montre était prohibée comme objet plus ou moins précieux, le tabac
devait rester aux
cachibis,
aux casiers de la dunette, car on ne fumait que sur le pont. C’est
ainsi qu’on charge le mannequin qui représente le C, huit jours
avant sa fête, la fête du grand C. Pourquoi le C ? C’est le chiffre
algébrique correspondant au matricule le plus élevé de la promotion.
À l’arrivée, on divise par ce chiffre le nombre de jours que la
promo(tion) doit passer sur le
Borda,
et l’on obtient une constante : C.
Par exemple, les
élèves ayant 630 jours à passer à bord, et le matricule le plus
élevé étant 178, on divise 630 par 178, ce qui donne 3 au quotient,
avec un reste de 96, le calendrier(-baille) sera donc ainsi établi :
le temps de séjour à bord, soit T = 3 x 178 + 96 (ou 3C + 96).
On célèbrera la
fête du petit C après 96 jours, quand l’équation portée au tableau
noir de la batterie donne : T = 3C, et ce sera la fête du grand C
quand elle ne donnera plus que T = C, et qu’il ne reste donc que 178
jours à passer au Borda.
Le lendemain, au
tableau noir : T = C – 1 : le jour où T = C – 178, libérera la
promotion. »
(LEN, p. LVI).
Aussi : … le
(grand)
C
représente dans le ciel une constellation, la
Couronne boréale.
On donne ce nom
de
(grand) C
à celui des élèves qui possède le numéro le plus fort à l’École.
(CMS,
p. 12).
Les élèves ont inventé la
fête du
(grand) C.
(op.
cit. 12)
… le jour
choisi pour la fête (du (grand) C). On (les élèves) fabrique(nt)
alors un mannequin orné de tous les engins et instruments
personnifiant un élève, et on lui fait subir le supplice de la cale.
(CMS,
p. 13)
Le Grand C,
l’apothéose, eut lieu le 13 janvier 1940. Auparavant, nous avions
été conviés – rappelle J…– à baiser le Père Antoine et à jurer (en
crachant) de respecter les Saintes Traditions. Pour cet ultime
beuglant, les Anciens avaient bien fait les choses… Les beuglants
aussi se succédaient. Il fallait bien nous apprendre, au même rythme
que notre instruction accélérée, les chansons Baille.
(EàE, p. 41).
De nos jours,
contrairement
à une idée reçue, il n’y a jamais eu d’action commune avec
Saint-Cyr.
Une année, des
anciens mirent la voiture personnelle d’un officier sur le ponton du
Transrade
[bâtiment de servitude assurant le transport (de) rade – Brest,
Cherbourg ou Toulon]. Lorsqu’il s’en aperçut son véhicule était 5 m
plus bas… il ne put le récupérer que 6 heures plus tard, à marée
haute.
Une autre année,
les anciens firent une critique du système strassique, et non des
personnalités de la strasse, comme d’habitude. L’aspi-major fut
convoqué par le Pape et cela coinça terriblement.
Seule la Veuve,
garante des tradi(tion)s, a le droit de consulter quelques heures
avant, le texte du (vase) grand C. Si quelque chose paraît de
mauvais goût (attaque du Pape, elle peut suggérer au
grand C
(→ 2 infra) de supprimer ceci ou cela. Les élèves restent
cependant libres théoriquement de faire ce que bon leur semble. Si
lors du grand C (→ 1 supra) les élèves (anciens et fistots)
dépassent les bornes, il peut arriver que le Pape quitte la salle.
Normalement, la
charogne personnelle des loufiats ou de la strasse n’est autorisée
qu’au grand C. Elle peut, parfois, être très méchante. Pour les
autres beuglants, la charogne strassique ne peut être
qu’impersonnelle : on connaît cependant des exceptions.
(D’une
conversation avec un ami officier de Marine).
2.
a) (Surnom du)
dernier admis au concours d’entrée (le
culot,
ou plutôt
culal
comme disent les X).
b) Nom du fistot
petit c
une fois promu à la dignité d’ancien.
En passant
ancien,
il devient
grand C
à son tour..
3. Par ellip. (beuglant
du) grand C.
4.
faire
le
C.
Loc.
vb.
(Avant 1913) faire la fête le jour du C.
Enc.
Cela consistait
en général à faire ce qui était défendu.
Étym.
fr. cour.,
abréviation mathématique « C » pour constante.
–––––
Tradi
du
grand
C
(grande tradi)
Au
Borda,
pour faire le C, un mannequin, à la confection duquel les anciens
avaient mis tous leurs soins, était exposé dans la batterie des
anciens. Comme indiqué plus haut, il figurait le mauvais élève-type,
sale, débraillé, aux cheveux démesurés en broussaille, indiscipliné,
frondeur, batailleur, intempérant et, pour tout dire, coupable de
toutes les infractions aux règlements de l’École.
« Ce mannequin
était donc amené par le titulaire du matricule malheureux sur la
dunette. En ce grand jour, les élèves, à titre exceptionnel, y
avaient librement accès. Encadré de deux factionnaires – le plus
grand et le plus petit des anciens – il se trouvait alors soumis à
une parodie de conseil de discipline que présidait l’ancien-major.
En présence des deux promotions assemblées et de l’état-major
de l’École, l’ancien-C prononçait le réquisitoire. À chaque crime
énoncé, les assistants hurlaient : « La cale, la cale ! » Un élève
faisait office d’avocat. Réquisitoire et plaidoirie, d’une
débordante fantaisie, évoquaient avec esprit, et souvent avec
talent, les divers incidents de la vie de l’École au cours de
l’année écoulée. Naturellement, officiers, professeurs et
instructeurs y étaient plaisamment pris à partie par voie
d’allusions plus ou moins transparentes. Les manies et travers des
élèves étaient soulignés pour la plus grande joie de l’assistance.
Finalement le
« C » était traditionnellement condamné
à subir le supplice de la cale, comme le réclamait l’assistance. Le
mannequin du C était alors hissé au bout de la grand’ vergue et, par
trois fois selon la coutume, plongé dans la mer parmi les cris et
les exclamations joyeuses des élèves.
On le repêchait
ensuite et l’on inspectait ses poches, dans lesquelles on trouvait,
en plus des objets incriminés (lors du réquisitoire), une petite
boîte métallique, étanche, contenant ses lettres personnelles
d’excuses. Rédigées avec art et malice, elles permettaient aux
officiers de se rendre compte des griefs formulés par les élèves.
Pour finir, on renouvelait le supplice en l’aggravant : le mannequin
était pendu par le cou à la grande vergue.
Pendant de
nombreuses années, la fête s’accompagnait, après le supplice du C,
de
l’adoration d’Ant(h)oine.
Un
beuglant
clôturait invariablement cette journée mémorable entre toutes.
Cette tradition a
survécu au transfert de l’École à terre, mais elle dut être adaptée
aux conditions nouvelles de la vie des élèves. Il ne pouvait
notamment être question, dans une caserne, de faire subir au « C »
le supplice de la cale ! Donc, mise en accusation, défense et condamnation
du « C » disparurent. En fait, les rites de cette grande fête
traditionnelle se trouvèrent complètement transformés.
À Laninon, les
élèves faisaient éditer chaque année, à l’occasion de la fête du
« Grand C » , une sorte de programme, illustré et rempli
« d’astuces » inspirées par les événements de la vie quotidienne de
l’École. Ce document rappelait un peu la manière de
L’Os-à-moelle
de Pierre Dac, accommodée à la sauce-baille. Mais, pour bien marquer
que « la tradition continuait », ces programmes étaient présentés
chaque année dans les termes rituels suivants :
Aux temps
héroïques de la Baille en bois, un malheureux, victime de son
franc-parler, paya d’un terrible mais juste châtiment quelques
lettres indiscrètes sur les sujets que l’on devine.
Dans sa bonté
bien connue, la promo ne voulant pas donner à ses fistots ce
spectacle terrible mais moralisateur et, désireuse cependant de
marcher jusqu’au bout dans le vertueux sentier tracé par les promos
précédentes, présente...
Et, pour être
plus explicite encore, un dessin représentant le mannequin du C
pendu en bout de vergue figurait toujours sur les programmes.
De nos jours, le
« grand C » se fête le jour du départ en permission d’été, à la fin
du mois de juillet.
À Lanvéoc, le
« grand C » consiste essentiellement en un
beuglant
où, sous la forme d’une revue, sont mis sur la sellette la plupart
des officiers-instructeurs, la
Veuve
et le
DDE
[directeur des études] en tête. Seul, le
pape
– par déférence – est tenu en dehors de toute participation à la
scène. Chaque acteur porte un uniforme que lui a prêté l’officier
qu’il doit représenter. Pour préparer cette manifestation
artistique, toutes les particularités, tous les tics des officiers,
toutes les phrases bizarres ou originales prononcées par eux, sont
soigneusement notés au cours de l’année. Le texte de la revue et sa
mise en scène sont ainsi préparés longtemps à l’avance.
Réduite à ces
rites nouveaux, la tradi du grand C revêt encore une grande
importance aux yeux des
bordaches
modernes. C’est
toujours la fête principale de l’École navale.
(LAB
s.v.
C).
Extraits des rubriques C (grand)
et tradi du dictionnaire de l’argot-Baille, JeuMeu.
Bibliographie :
CMS
Croquis maritimes, Sahib ; Léon Vanier ; 1880.
EàE
D'éléphant à éléphant. Pierre Augey. Toulon : Presses de
l'Imprimerie du Sud-Est, 1980.
LAB
L'ÉCOLE NAVALE ET SES TRADITIONS
l’argot-baille,
aussi référencé : Dictionnaire étymologique et anecdotique de
l'argot-baille, d’après titre p. 45. Roger Coindreau ; Brest :
Perceval-Ozanne, 1957.
LEN
L'ÉCOLE NAVALE, Jean de La Varende ; Paris :
Amiot-Dumont, 1951. »
Remerciements

|